- Programme de recherche achevé,
- TRACES RHAdAMANTE,
- TRACES TERRAE,
-
Partager cette page
Celtic Gold
Fine metal work in the Western Latène culture
ANR
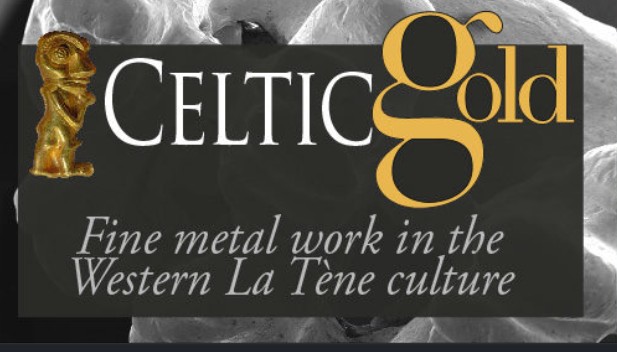
Le projet "CELTIC GOLD" est un programme FRAL (franco-allemand) interdisciplinaire, international et qui mobilise des agents de différentes institutions (CNRS, universités, centres de recherche, laboratoires d'archéométrie, musées, instituts archéologiques...). Dirigé par B. Armbruster et R. Schwab, il est cofinancé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), et hébergé par le laboratoire TRACES (Toulouse) et le CEZ Archäometrie (Mannheim).
À travers l’étude des productions et de la consommation des objets en or du second âge du Fer, il vise à renouveler l’appréhension de la culture laténienne occidentale (milieu Ve-Ier siècle av. J.-C.) en abordant son développement économique, social, technologique et artistique. S’étendant sur une grande partie de l’Europe continentale et sur les îles Britanniques, cette culture du second âge du Fer est caractérisée par de nouvelles dynamiques sociales et économiques, résultant en partie du resserrement des contacts avec les régions méditerranéennes (commerce, mercenariat, mobilités individuelles...) et des phénomènes de migrations des populations celtiques. Ce nouveau contexte a des incidences stylistiques et technologiques directes sur les productions métalliques.
Le projet CELTIC GOLD s’inscrit dans la continuité d’un précédent programme ANR-DFG qui portait sur l'or hallstattien occidental (West Hallstatt Gold). Ce dernier s’est clôturé lors d’un colloque international (Toulouse, 2015).
La période du second âge du Fer celtique est en effet cruciale pour le développement de l’art celtique, au sein duquel l’or apparaît comme un support privilégié. Majoritairement issus de contextes funéraires (tombes riches), plus ponctuellement de dépôts non funéraires (dépôts dits « rituels »), de sanctuaires, d’habitats ou de découvertes isolées, ces objets de luxe permettent d’aborder l’ensemble des aspects liés à l’or de l’époque laténienne : de l’approvisionnement en matière première à l’abandon des objets, en abordant les questions des techniques de fabrication, des formes artistiques, de leur usage et de leur diffusion, jusqu’à leurs contextes de dépôt et, finalement, la manière dont ils ont été découverts et interprétés. Ces différentes observations, ainsi que les changements stylistiques et techniques décelés à partir de ces objets précieux, seront replacés dans le contexte socio-économique et technologique de la culture laténienne, contribuant à alimenter les discussions et les interprétations historiques, archéologiques, archéométallurgiques et théoriques.Parallèlement, le second âge du Fer est caractérisé par l’apparition et le développement des monnayages en or (d’abord dans l’aire culturelle grecque, carthaginoise, celtique et enfin romaine), concomitant d'un nouveau système d’échange et de l’exploitation de nouvelles sources de matières premières. Nous prendrons en considération les monnaies, en particulier lorsqu’elles sont associées aux objets en or qui intéressent notre étude. Elles permettront de croiser les informations sur leur composition, la provenance supposée de leur matière première et leur valeur économique, ainsi que sur leur probable utilisation comme matière de récupération pour l’orfèvrerie. Le constat de l’intensification de l’exploitation des mines d’or (en particulier dans le Limousin) apporte également un point de vue intéressant et novateur.
Nous avons choisi d’aborder plus spécifiquement une aire géographique s’étendant de l’Allemagne à la France, en passant par le Benelux et la Suisse. Le travail d’orfèvrerie se prête tout particulièrement à la mise en évidence de traditions et d’innovations locales, ainsi qu’à celle des influences étrangères et des réseaux d’échanges au sein des arts et métiers, attestant de la mobilité des personnes, des objets et des idées.
La cohérence du projet réside dans l’étroite collaboration internationale et interdisciplinaire entre partenaires scientifiques allemands et français. Nos compétences réunies permettront de combiner activement l’expertise en archéologie (fig. 2a), en technologie (fig. 2b) et en sciences des matériaux (fig. 2c). Cette expertise s’appuie également sur l’utilisation de nouveaux équipements performants, permettant des observations et des analyses de matériaux de très grande précision et très peu invasifs. Une démarche expérimentale permettra également de mettre à l’épreuve les résultats obtenus.
Participant·e·s
- M. BLET-LEMARQUAND (ingénieure de recherche ; CNRS – CEB-IRAMAT, Orléans)
- S. FÜRST (post-doctorant ; RGZM, Mainz)
- N. LOCKOFF (assistante de recherche ; CEZ Archäometrie, Mannheim)
- P.-Y. MILCENT (maître de conférences HDR ; Université de Toulouse-Jean Jaurès – UMR 5608 TRACES, Toulouse)
- S. NIETO-PELLETIER (chargée de recherche ; CNRS – IRAMAT, Orléans)
- M. NORDEZ (post-doctorante ; CNRS - UMR 5608 TRACES, Toulouse)
- L. OLIVIER (conservateur ; MAN, Saint-Germain-en-Laye)
- M. SCHÖNFELDER (chercheur ; RGZM, Mainz)
- S. SIEVERS (professeure ; Université de Frankfurt)






